1924-1925, Le Cartel des Gauches ; Première Partie :
L'affaire de la Ruhr n'a pas été seule à retenir en 1923 l'attention des pouvoirs publics français.
Sur le plan extérieur, la conférence de Lausanne a abouti, le 24 juillet à un traitéqui, dans l'ensemble, est favorable à la Turquie, ce que souhaitait la France. Grace à l'énergie de Kemal pacha et à sa ténacité, la Turquie, si la perte de ses provinces arabes lui est confirmée, trouve en Europe des frontières meilleures que celles de 1913. Il convient de mentionner aussi la poursuite de la négociation entamée entre notre ambassade au Vatican et le Saint-Siège au sujet de ces « associations diocésaines » qu'on souhaiterait substituer aux « associations cultuelles » prévues par la loi de séparation et que l'intransigeance du pape Pie X empêcha d'instituer, négociation qu'en dépit d'une bonne volonté réciproque ont rendu délicate les réticences des évêques français nommés par le pontife défunt. On aboutit enfin en décembre 1924 et le pape Pie XI va, le 18 janvier, publier l'encyclique « Maximam gravissimanque » approuvant la constitution des nouvelles associations. Les anciens biens de l’Église se trouvant déjà liquidés, elles n'auront d'ailleurs pas de patrimoine à gérer.
Sur le plan intérieur, signalons la tentative faite pour remettre pleinement en honneur, dans l'enseignement secondaire, les études gréco-latines. Le 3 mai, sur l'initiative du Ministre de l'instruction publique Léon Bérard, un décret a été promulgué rendant obligatoires pour tous les élèves des lycées et collèges le latin depuis la sixième jusqu'à la troisième comprise et le grec en quatrième et en troisième.
Cette modification des programmes de 1902 (lesquels prévoyaient la possibilité d'un cycle complet d'études sans langues anciennes) parut à gauche empreinte d'esprit réactionnaire et, à son propos, un débat s'institua devant la Chambre qui remplit de nombreuses séances. Un ordre du jour pur et simple comportant approbation implicite du décret fut approuvé par 307 voix contre 216. Mais ce succès du ministre humaniste était destiné à rester éphémère.
A indiquer aussi la promulgation, le 27 décembre, d'une nouvelle loi sur les loyers : fixant rétroactivement le maximum des majorations applicables aux prix en vigueur en 1914, elle attribue à l’État le droit d'intervenir dans des contrats privés et de protéger une catégorie de citoyens (dans l'espèce les locataires) contre une autre catégorie (dans l'espèce les propriétaires). Il se révélera presque impossible de revenir sur le principe ainsi posé, et ce sera là la grande cause de cette crise de logement qui acquerra plus tard tant d'ampleur.
Quand s'ouvre l'année 1924, c'est décidément la question financière qui prend le pas en France sur toutes les autres.
Ami de la clarté en matière budgétaire comme en tout, le président du Conseil a, dès1923, affirmé la nécessité de fondre le budget des dépenses dites « recouvrables » avec le budget ordinaire et d'équilibrer l'ensemble par des recettes normales. En exécution de ce plan, le ministre des Finances, Charles de Lasteyrie, a déposé un projet créant 6 milliards de recettes nouvelles, grâce notamment à une majoration de 20 % de tous les impôts (le double décime).
On avait trop longtemps vécu dans la facilité pour que cet acte de courage ne fut pas mal accueilli par l'opinion. Soucieuse de gagner sans encombre la date des élections, la Chambre ajourna la discussion du texte gouvernemental et, renonçant même à voter le budget de 1924, se contenta de reconduire pour un an celui de 1923.
Les spéculateurs étrangers prirent prétexte de cette tergiversation pour redoubler d'attaques contre le franc. Le dollar qui, à la veille de l'occupation de la Ruhr, cotait 13 francs, en cote 20 en janvier 1924.
Alarmés, Poincaré et Lasteyrie reprennent leur projet. Pour donner toutefois satisfaction aux tendances anti-étatistes de la majorité, ils ajoutent au double décime une disposition remplaçant par une taxe fiscale le monopole des allumettes dont l’État se déssaisirait ; ils y joignent aussi des mesures destinées à réduire le nombre des fonctionnaires.
Effervescence à Gauche : les radicaux-socialistes, maintenant tous passés à l'opposition sous la conduite d’Édouard Herriot, s'unissent aux socialistes pour combattre l'ensemble du projet. En dépit de plusieurs appels pressants de Poincaré, les débats se prolongent, cependant que, le 8 mars, le dollar atteint le cours de 29 francs et la livre sterling celui de 123 francs.
Le 9 mars, un Conseil extraordinaire des ministres se réunit à l’Élysée. Il est décidé de passer à la contre-offensive, en d'autres termes de faire intervenir la Banque de France sur le marché des changes. Les munitions sont empruntées à divers établissements anglais et à la banque Morgan de New-York (qui ouvre à elle seule au gouvernement français un crédit de 89 millions de dollars).
La conjoncture est favorable, car, fouettée par Poincaré, la majorité du Parlement s'est résignée à voter les mesures d'économie puis l'ensemble des textes fiscaux. Dès le 15 mars, le dollar ne cote plus que 21 francs et la livre que 90 francs ; en avril, le premier tombera à moins de 16 francs, la seconde à moins de 64 francs et la Banque de France rachètera avec bénéfice les devises vendues.
L'imminence des élections rend la Chambre de plus en plus nerveuse, et la bataille des changes n'est pas terminée qu'il se trouve une majorité de 7 voix pour repousser une disposition relative aux pensions, disposition à propos de laquelle le ministre des Finances a posé la question de confiance. Le gouvernement est démissionnaire.
Poincaré n'a pas été personnellement atteint par ce vote et il se voit aussitôt chargé par Millerand de former un nouveau cabinet.
Celui-ci est sur pied le 29 mars, c'est-à-dire après vingt-quatre heures de crise seulement. Le président du Conseil n'y a conservé que deux membres du ministère précédent, Maginot, ministre de la Guerre, et Le Troquet, ministre des Travaux Publics.
S'il a cru, par un changement aussi complet d'équipe, renforcer son autorité, il s'est trompé : l'opposition se fait plus violente que jamais. On taxe la politique du Bloc national de « bellicisme », on lui fait grief de l'occupation de la Ruhr et des dépenses qu'elle a entraînées ; in lui reproche d'avoir distendu les liens de l'amitié franco-britannique et d'avoir pactisé avec le Vatican ; on lui reproche aussi de s'être asservie aux grandes entreprises privées et d'avoir, dans l'affaire des allumettes, porté une mai sacrilège sur un monopole d’État ; on lui impute à crime à la fois la crise financière et les mesures prises pour y mettre fin ; in va même jusqu’à accuser Poincaré de n'avoir redressé le franc qu'en apparence et dans un souci purement électoral.
La campagne est menée avec une ardeur particulière dans les colonnes d'un organe politique de gauche, « le Quotidien », fondé par l'adroit journaliste Henri Dumay pour élargir l'action d'un hebdomadaire préexistant et déjà influent « le Progrès civique ».
Comptant dans sa rédaction plusieurs éminents universitaires, bien rédigé, affectant une attitude vertueuse et moralisatrice, « Le Quotidien » a vite recruté une clientèle nombreuse chez les petits fonctionnaires et les maîtres de l'enseignement primaire (sur 120 000 instituteurs et institutrices environ, 75 000 adhérents à la C.G.T. socialiste, et 15 000 à la C.G.T.U. communiste). Appuyé sur cette clientèle et aidé par la « Ligue de la République », il a provoqué sous le nom de « Cartel des Gauches », une alliance des radicaux-socialistes avec les socialistes et il a suscité, dans tous les départements, la constitution de comités chargés de rendre cette alliance efficace. Il apparaît vite que les slogans inlassablement répétés par lui (« Pour la paix », « Contre la Ruhr », « Pour les petits », « Contre le cléricalisme », « Contre les puissances d'argent », « Contre le double décime ») rencontrent un vif succès.
L'anticléricalisme était pour l'opinion une vieille connaissance. Mais elle était peu habituée à ce que les grandes questions de politique extérieure comme de politique financière fussent agitées devant elles par la gauche et elle s'ébahit devant l'assurance avec laquelle le cartel les traite… Nouveauté lourde de conséquences : désormais la conduite de la diplomatie et des finances va prendre en France, sauf pendant de brèves périodes, un caractère partisan.
Millerand s'est tôt aperçu du danger et, sortant de sa réserve constitutionnelle, il a, dès le mois d'octobre 1923, prononcé à Évreux un grand discours dans lequel il s'est efforcé de défendre l’œuvre du Bloc national et a réclamé en outre une réforme constitutionnelle tendant à renforcer l’exécutif. En revanche, Poincaré paraît se désintéresser de son rôle de chef de la majorité et se consacre principalement aux négociations internationales en cours.
Le gouvernement du Reich n'a eu aucune peine à convaincre les experts anglo-saxons qu'un rapide relèvement de l'économie allemande était dans l’intérêt général. Partant de là, le comité Dawes a élaboré un plan limitant les paiements de réparations à une somme d'un milliard de marks-or par an (pouvant il est vrai, s'élever par la suite à deux milliards et demi). A ces annuités seraient affectées, sous contrôle d'un agent général de nationalité américaine, un certain nombre de recettes domaniales et fiscales.
Le 11 avril, la Commission des réparations entérine ce rapport et signe du même coup sa déchéance. Le 18, le gouvernement français donne au plan Dawes une approbation de principe.
Les tractations n'ont, en France, que fort peu d'influence sur la bataille électorale.
Les élections doivent avoir lieu le 11 mai selon le système de 1919 à peine modifié ; système en principe proportionnel mais comportant une forte prime à la majorité. En 1919, cette prime a joué contre les gauches, très désunies, et en faveur du Bloc national, fortement cimenté. En 1924, la situation est inversée : tandis que le Cartel des gauches manifeste une parfaite cohésion, le Bloc national, dont nombre de membres ont fait défection, n'est plus guère que l'ombre de lui-même. Aussi sort-il écrasé du scrutin. Les déplacement des voix est, à vrai-dire, faible mais suffit à renverser complètement la majorité parlementaire : dans la Chambre nouvelle, le Cartel obtient 388 sièges sur 582, les communistes, presque tous travailleurs manuels, sont 28 ; le centre et la droite n'ont ensemble que 226 élus. C'est le Midi qui a assuré la victoire du Cartel.
Poincaré est trop respectueux de la légalité républicaine, trop soucieux aussi d'éviter l'indélébile étiquette de « réactionnaire » pour suivre le président de la République dans ses velléités de résistance. Le 31 mai, veille de la réunion de la nouvelle Assemblée, il porte à l’Élysée la démission du ministère. Il quitte le pouvoir sans amertume apparente. Sa foi dans le triomphe final de la raison lui donne la conviction que son heure reviendra.
Il ne se trompe pas. Il n'en n'a pas moins laissé échapper, dans la Ruhr, une occasion qui ne s'offrira plus à la France.
La Chambre élue le 11 mai 1924 se réunit au milieu d'une effervescence générale. Les vainqueurs clament leur volonté d'engager le pays dans des voies entièrement neuves. Les vaincus prédisent les pires catastrophes. Selon leur orientation, les journaux d'opinion enchérissent sur l'optimisme des uns, sur le pessimisme des autres.
La mystique carteliste – car il s'agit d'une véritable mystique – est faite de bon nombre d'idées généreuses et sincères. Mais, à coté, le souci d’intérêts très particuliers n'est pas absent. Ce souci, « le Quotidien » l'affiche non sans candeur quand il imprime : « Toutes les places et tout de suite. ».
La plus en vue des places est la présidence de la République. Son titulaire, Millerand, fut, au début de la précédente législature, l'animateur du Bloc national et, comme tel, il est resté honni de la Gauche. Parvenu à la première magistrature de l’État, il lui est arrivé de sortir de la réserve imposée, sinon par la lettre, au moins par la pratique de la Constitution : en particulier, il a, au mois d'octobre 1923, prononcé à Évreux un discours qui a pu être qualifié de partisan. Bête noire du « Quotidien », celui-ci exige impérieusement son renvoi.
Le chef de l’État est irresponsable et seul un jugement du Sénat constitué en Haute Cour pourrait légalement le priver de sa charge. D'un tel jugement, il ne saurait être question. Mais il existe un moyen de parvenir au même résultat : empécher le président de constituer un gouvernement viable.
Si Poincaré ne s'était pas retiré, peut-être celui-ci aurait réussi, son autorité personnelle aidant, à grouper une faible majorité. Il s'est refusé à le tenter. Pour lui succéder, Millerand fait appel à Édouard Herriot, chef du groupe radical-socialiste, le plus nombreux du Cartel. Mais, après consultation avec Léon Blum, leader des socialistes S.F.I.O.n Herriot se dérobe. Le président de la République se tourne alors vers Painlevé, républicain socialiste, puis vers Steeg, radical. Refus successifs : aucun élu carteliste ne doit prêter son concours au chef de l’État.
En désespoir de cause, celui-ci, maintenant véritable « homme traqué », s'adresse à son ami personnel, le sénateur François Marsal, naguère ministre des Finances. François Marsal se dévoue et constitue à la hâte un cabinet composé d'anciens membres du Bloc national. Le 10 juin, ce cabinet se présente devant les Assemblées auxquelles lecture est donnée d'un message-plaidoyer du président de la République. Au Palais-Bourbon, une interpellation est aussitôt développée que clôt un ordre du jour aux termes duquel la Chambre se refuse à entrer en contact avec le ministère. Cet ordre du jour a été voté par 327 voix contre 217.
Privé de ministres, assuré de ne pas obtenir du Sénat l'avis favorable qui lui serait nécessaire pour dissoudre la Chambre, Millerand n'a d'autre issue que la démission. Il s'y résigne et la presse carteliste triomphe. Voici donc l’Élysée vacant. L'aile gauche du Cartel voudrait y pousser Paul Painlevé, qui est l'un des siens et qui, de plus, en tant que mathématicien, jouit d'une réputation européenne. Mais le président de la République et l'élu des deux Chambres. Or, si la majorité du Sénat n'a pas soutenu Millerand, elle n'en n'a pas moins été effrayée par l'audace de ses adversaires et elle s'inquiète des « aventures » possibles. Au Palais-Bourbon, cette même inquiétude est partagée par les membres de la Gauche radicale (radicaux indépendants), lesquels bien qu'ayant adhéré au Cartel, sont des conservateurs sociaux.
Une coalition se forme qui, contre Painlevé jugé trop engagé dans la lutte partisane, met en avant le nom de Gaston Doumergue, président du Sénat, protestant très « laïc », incontestable homme de Gauche, mais fort hostile au socialisme et d'une cordialité toute méridionale. Le 13 juin, les deux Chambres réunies à Versailles en Assemblée nationale portent Doumergue à la présidence de la République par 515 voix contre 309 données à son adversaire. Premier échec du Cartel ; Poincaré, qui a repris son fauteuil de sénateur n'y a pas été étranger.
Jouant correctement le jeu parlementaire, le nouveau président de la République charge Herriot de former un gouvernement.
Âgé maintenant de cinquante-deux ans, député du Rhône, maire de Lyon, Édouard Herriot a fait comme boursier de solides études, est passé par l’École normale supérieure et en est sorti agrégé de lettres. Ayant abandonné le professorat pour la politique, il a, après quelques tâtonnements, adhéré au parti radical-socialiste et s'en est vite révélé l'un des plus brillants orateurs. Pendant la guerre, il a fait partie d'un ministère Briand, a ensuite accentué son orientation à gauche, s'est prononcé contre l'occupation de la Ruhr, a pris la tète de l'opposition et a largement contribué à la victoire du Cartel.
Très fin lettré, artiste, causeur charmant, éblouissant conférencier, idéaliste, sincère mais habile à utiliser cet idéalisme comme moyen de séduction, démocrate dans les moelles, fervent patriote à la manière de Michelet, doué dans tous les domaines d'un vigoureux appétit, ayant le don des larmes et le sens de la manœuvre parlementaire, sensible à la flatterie, il est bien l'homme de cette « République des professeurs » dont les élections du 11 mai ont marqué l'avènement. Pendant quelques temps, la « bouffarde » qui ne quitte guère ses lèvres charnues va être comme un emblème national.
Le président du Conseil désigné souhaiterait fort que le groupe socialiste S.F.I.O. fut représenté au sein de son gouvernement, et il écrit dans ce sens au chef de ce groupe une lettre commençant par « Mon cher Blum », formule qui paraît à beaucoup d'une familiarité contraire aux usages.
Issu d'une famille de bourgeoisie israélite aisée, ancien maître des requêtes au Conseil d’État, ancien critique dramatique à la « Revue blanche », auteur de plusieurs essais dont l'un sur « le Mariage » fit quelque scandale, Léon Blum, du même qu'Herriot, normalien comme lui, ne lui ressemble pourtant guère. Relevant du genre esthète plutôt que du genre universitaire, il est long, mince, nerveux, et son éloquence témoigne de plus d'ingéniosité didactique que de chaleur. Socialiste convaincu avec cela, familier d'Hegel et de Karl Marx, il met, dans ses attaques contre l'ordre établi, une âpreté étrangère à Herriot. Tacticien subtil enfin, il ne tient nullement, en compromettant son parti dans un gouvernement bourgeois, à faire le jeu des communistes. Aussi, d'accord avec la plupart de ses amis politiques, répond-il négativement à l'offre qui lui est faite. Il assure toutefois son « cher Herriot » que les voix de la S.F.I.O. ne lui manqueront point : ce sera le « soutien sans participation ».
A suivre...


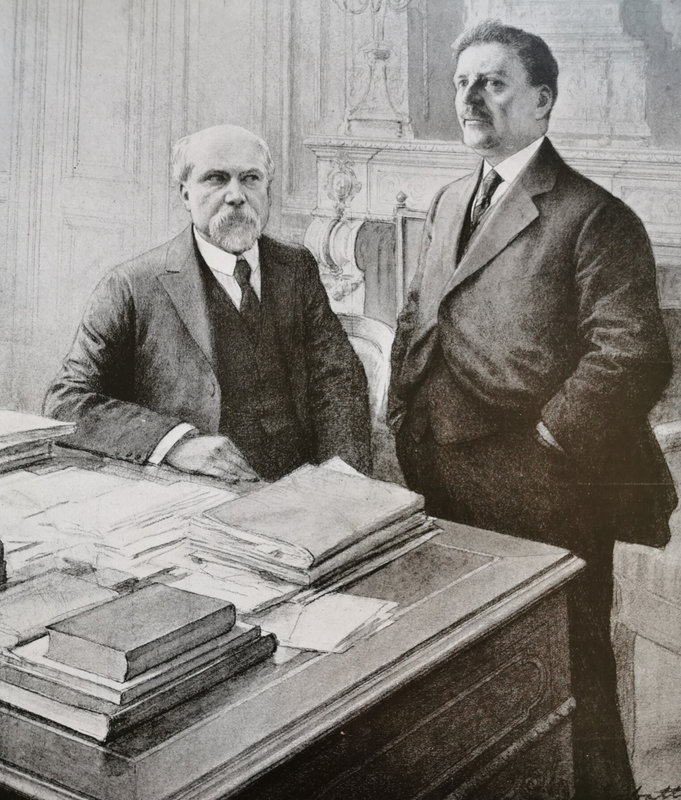


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F29%2F347455%2F131521992_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F56%2F347455%2F131090582_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F07%2F347455%2F131039842_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F17%2F347455%2F131001077_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F14%2F347455%2F65749016_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F44%2F347455%2F65658020_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F88%2F347455%2F64762918_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F98%2F347455%2F60122316_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F61%2F347455%2F27908141_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F9%2F298788.jpg)